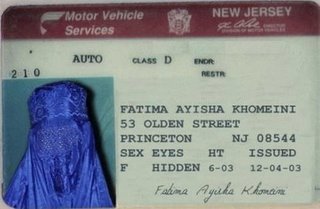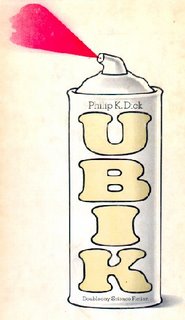Hommage à la Hongrie

Pour commémorer à ma façon l’anniversaire de l’insurrection de Budapest, parlons de l’œuvre principale d’un écrivain hongrois, Ferenc Karinthy. Ce roman se doit d’être un pilier de la littérature kafkaïenne ; rien que son titre est déjà empreint d’une inquiétante étrangeté :
Epépé.
Un linguiste prend l’avion pour Helsinki afin d’assister à un congrès. Or à son arrivée, dès l’aéroport, il se rend compte qu’il n’est pas en Finlande, et qu’il a dû se tromper de vol. En route pour l’hôtel ou il a décidé de passer la nuit, il s’aperçoit qu’il n’arrive pas à identifier le pays qui l’entoure. Pire, il ne reconnaît ni la langue, ni l’écriture, ni même le type physique des habitants. Ce qui est d’autant plus frustrant que Budaï –c’est son nom, fait mieux que parler plusieurs langues, il maîtrise plusieurs langues. Les gens autour de lui sont d’une indifférence glacée, il ne croise aucun autre étranger. Et très vite, il se retrouve piégé dans une ville immense et les évènements qui s’ensuivent tournent –forcément- au tragi-comique.
L’écriture est distanciée, factuelle, parfois teintée d’une légère ironie : le héros est toujours évoqué à la troisième personne, on ne sait rien de lui, ce qui renforce l’impression de voir une fourmi évoluer dans une labyrinthe. Le tour de force de Karinthy, lui-même linguiste de formation, est d’avoir su créer, pour les rares fois ou les autochtones s’expriment, une langue qui ne ressemble strictement à rien pour le lecteur, quelque soit sa culture d’origine.
Il a su également créer un pays, une ville, qui ne serait qu’un archétype, l’idée (au sens platonicien) de la ville moderne oppressante. Ou la solitude est d’autant plus pesante qu’elle est entourée d’une foule grouillante et perpetuelle. Surtout quand cette solitude est une solitude essentielle : celle du langage.
Parfaite fable cauchemardesque, c’est un bouquin que c’est trop d’la balle.